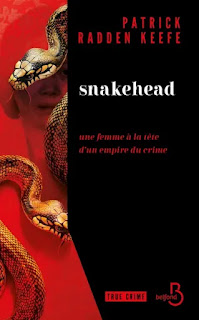Snakehead
– Patrick Radden Keefe
(The
Snakehead: An Epic Tale of the Chinatown Underworld and the American Dream, 2009)
Belfond,
2025, 384 pages
Traduction
de Chloé Royer
Dans le même esprit que le recueil d’enquêtes paru l’an dernier (en France), Snakehead s’intéresse à l'immigration clandestine entre la Chine (et plus particulièrement la région du Fujian) et les Etats-Unis, à travers un personnage « mythique », Sister Ping.
Le récit est passionnant ! Il se lit comme un roman, facilement et avec un certain suspense. Cela tient à ce que le journaliste se concentre sur les protagonistes. S’il retrace l’histoire et le fonctionnement de ces organisations de passeurs, Radden Keefe personnalise beaucoup le propos en s’appuyant sur des figures particulières de ce trafic.
Mais l’auteur prend aussi du recul pour retracer l’histoire de l’immigration chinoise aux Etats-Unis, et des diverses politiques américaines au fil du temps, les raisons pour lesquelles les Chinois du Fujian ont été particulièrement nombreux à émigrer aux Etats-Unis, etc. Il creuse aussi l’aspect culturel de cette communauté, entre le Fujian et le Chinatown de New York en particulier, le fonctionnement de la « mafia chinoise », ses particularités.
Si l’épilogue est plus déceptif, l’auteur se perdant un peu dans une
pseudo-analyse étriquée de l’immigration, le reste est vraiment prenant et
instructif : une lecture à recommander !